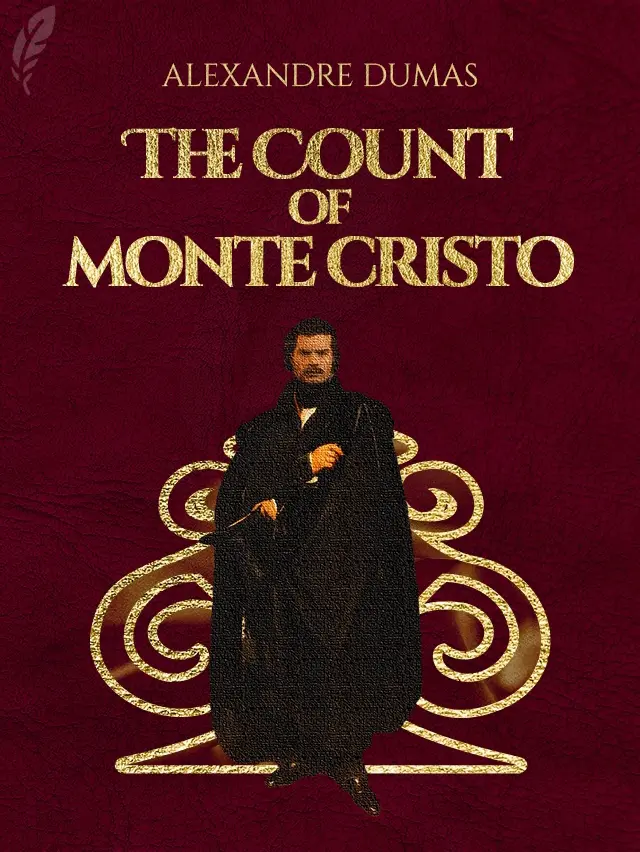
The Count of Monte Cristo
Alexandre Dumas
Adventure
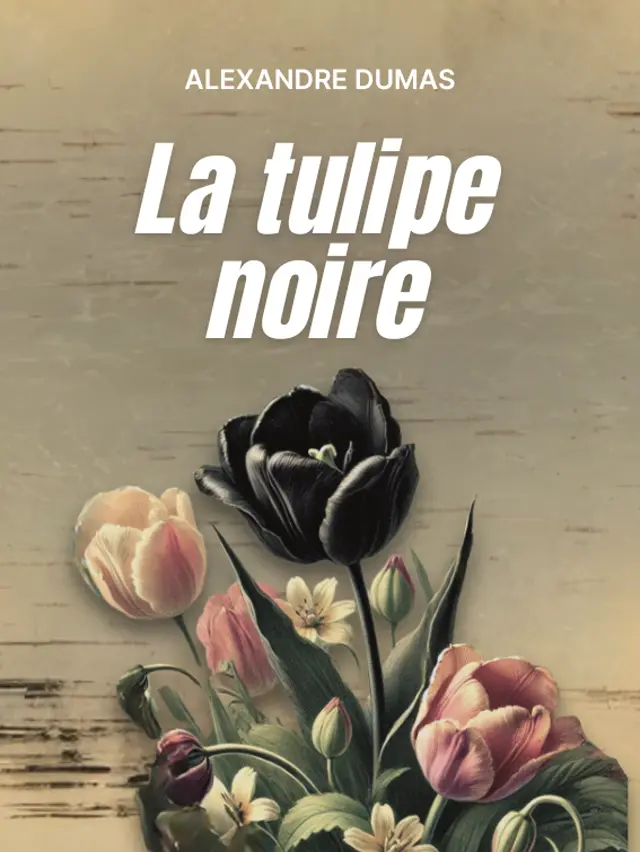
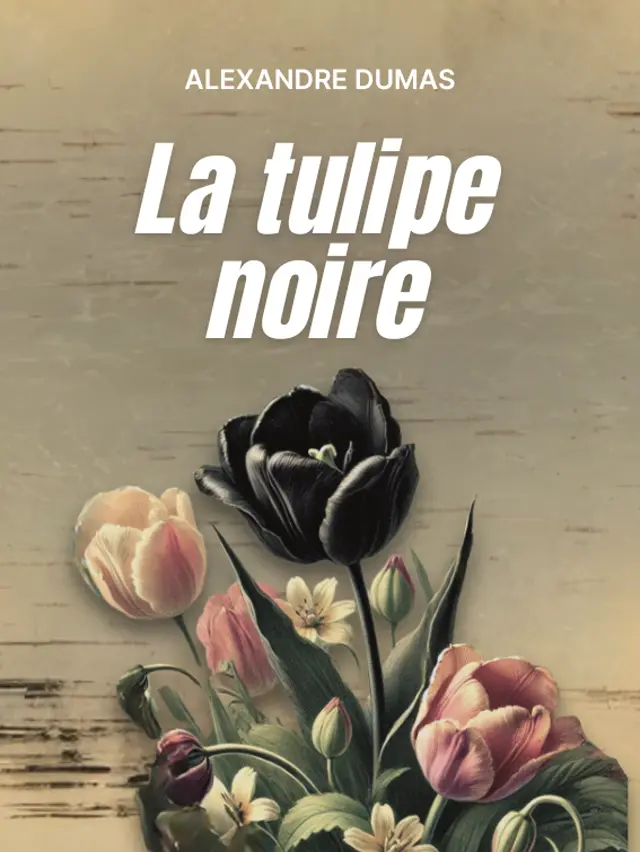
Audiobook Available
Listen to La tulipe noire in the app. It's free and ad-free.
Révélant l'essence dramatique et romantique du XVIIe siècle, "La Tulipe Noire" d'Alexandre Dumas nous entraîne dans une aventure botanique pleine de mystère et de trahison.
Author
Read by
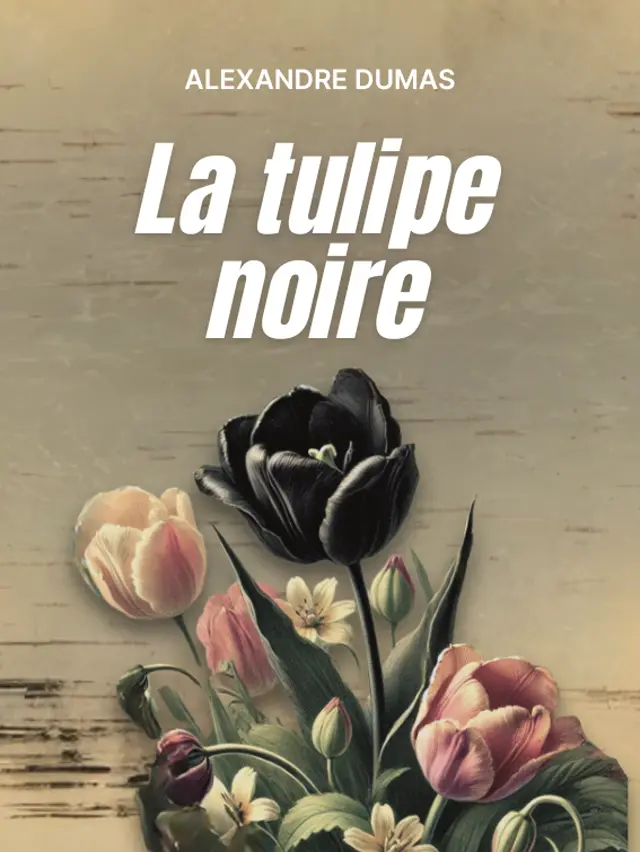
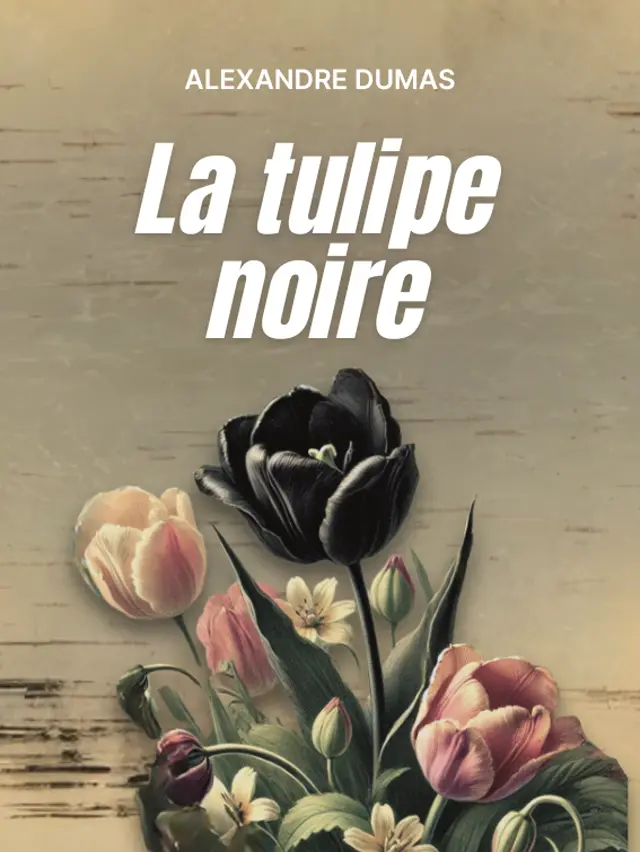
Audiobook Available
Listen to La tulipe noire in the app. It's free and ad-free.
Révélant l'essence dramatique et romantique du XVIIe siècle, "La Tulipe Noire" d'Alexandre Dumas nous entraîne dans une aventure botanique pleine de mystère et de trahison.
Author
Read by
Total ratings
3
Average rating
4.7
/ 5
★★★★★
Rating breakdown
Last 12 months
Total reviews
No reviews yet.